Et la musique dans tout cela ?
Lully est-il autre chose qu’un courtisan, un simple compositeur de cour ambitieux, flattant son monarque pour grimper toujours plus haut ? Plutôt un extraordinaire novateur qui maîtrisait aussi bien la musique, que le théâtre, la danse, la direction d’orchestre et l’art de la dramaturgie.
Atys donne cette étonnante impression que la musique n’est peut-être pas ce qu’il y a de plus important dans un spectacle, ou dit autrement, la musique n’a rien ici d' »ostentatoire », avec des airs faciles à retenir ou qui éclatent de virtuosité : elle est en fait totalement au service du livret, de cette tragédie intime très bien écrite : les vers de Quinault sont précis, concis, pas de temps à perdre en verbiage. La syntaxe est classique, très belle, mais jamais ennuyeuse dans sa rythmique : l’intrigue avance vite, la tension ne retombe pas. William Christie explique qu’il demandait régulièrement aux interprètes « chantez moins, dites plus », comme si le texte pouvait presque exister par lui-même, qu’il méritait une parfaite diction.
Et ce drame mis en musique bénéficie d’un surprenant orfèvre de la partition, qui suit, vers après vers, la progression des tensions, les humeurs indécises des héros, les incompréhensions, les malentendus. La musique s’adapte immédiatement aux états d’âme des personnages : concrètement, on passe presque sans s’en rendre compte des nombreux récitatifs (clavecin) aux airs très courts (théorbe, viole de gambe, basse de violon, luth) sans contraste marqué. Tout est fluide, comme l’est la langue. Lully ne verse pas dans la recherche de l’effet mais préfère la retenue, l’élégance, la délicatesse, on n’oserait dire la simplicité, tant ce terme semble jurer avec le baroque, et pourtant ! Sangaride et Atys n’ont pas besoin de roucouler un grand air racoleur à vocalises débridées à l’acte IV, lorsqu’ils comprennent que leurs soupçons d’infidélité sont vains : il leur suffit de murmurer à deux reprises, portés par le continuo, Je jure, Je promets, De ne changer jamais, pour que l’émotion passe, dans des nuances éthérées, intimes et suaves.
Il y a bien sûr cette scène mythique du sommeil d’Atys à l’acte III, où l’orchestre se double sur scènes de sept musiciens : à la douceur grave de deux archiluths, se joignent des flûtes quasi hypnotiques, les voix d’un quatuor masculin stupéfiant et un danseur aérien qui virevolte autour d’Atys assoupi : onze minutes que l’on savoure pétrifié, bercé d’une poésie rarement atteinte et d’une extrême mélancolie.
La nouvelle génération d’interprètes (à l’exception de deux chanteurs qui rempilent 24 ans après) est à la hauteur du challenge : diction impeccable, présence forte, belle gestuelle, voix superbes ; les deux amoureux Bernard Richter (Atys) et Emmanuelle de Negri (Sangaride) s’expriment avec un naturel confondant, de beaux timbres, des voix claires, des aigus lumineux, des modulations très subtiles. Le quatuor du « Sommeil » est un sommet d’élégance, où l’on retrouve Paul Agnew (quel dommage que son texte soit si court) qui retient ses notes, légères et aériennes, sans jamais chercher à tirer la couverture à lui.
Ça coince en revanche avec la Cybèle de Stéphanie d’Oustrac, que je trouve en total décalage avec l’homogénéité de la troupe : est-ce volontaire, de part sa condition de déesse ? L’articulation est plus que forcée, la voix trop étudiée, trop lyrique, en comparaison avec l’extrême finesse de ses camarades de jeu. Et cette manière de brailler, quand les autres respirent en musique, que c’en est vite crispant ! Ce sur-jeu permanent, cette interprétation emphatique et bien trop affectée pour être sincère, ses yeux écarquillés, ses poses qui n’en finissent pas, n’ont rien à voir avec le sens du drame. On comprend que le gracieux Atys préfère sa douce nymphe à cette furie-virago.
William Christie retrouve la partition avec un bonheur palpable : la musique n’a rien de poussiéreux ou de daté. L’orchestre est à la fois tonique dans les ouvertures, puissant et généreux dans le drame, et subtil dans des sonorités moelleuses et onctueuses, soulignant toutes les subtilités du livret et attentif à la moindre respiration des chanteurs. Expressif, je ne trouve pas d’autre mot.

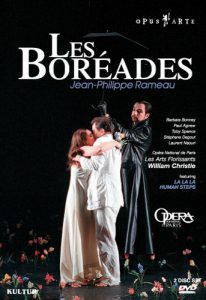
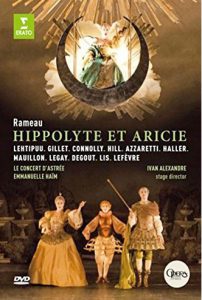
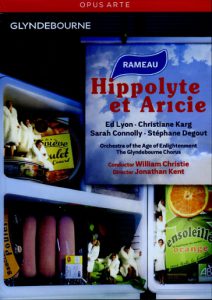
Quinault-Lully, la même farine?
Pardonnez ce double jeu de mots, mais sa base est « historique » (d’époque), le dit Quinault étant effectivement fils de boulanger.
Avant toute exégèse, ma réaction à cette vision-audition, magnifiquement restituée néanmoins: tout le monde l’a souligné, un un peu long prologue, mais avec un texte « cul-cul-la praline » comme on en a rarement fait de pires! Une « pastorale » avant une tragédie… Bon, heureusement après, la musique l’emporte sur les mots, qui se voient contraints de concentrer leur propos.
Travail à quatre mains? Lully, qui payait rubis sur l’ongle, ne le cachait pas: Quinault « était « le seul qui pût l’accommoder, et qui sût aussi bien varier les mesures et les rimes dans la poésie, qu’il savait lui-même varier les tours et les cadences en musique. »
Mais quid du libertinage, & de l’humour, qui à l’époque présidaient ? Lully se méfia d’un La Fontaine (pour un projet Daphné – « livret bon pour finir à la chaise percée ») avec ses Contes…
Quinault lui-même, reclus en religion à la fin de ses jours,regrettait (L’Hérésie détruite) d’avoir « trop chanté les jeux et les amours »…
Bravo à lui sans doute,– quoique « poète sans fond et sans art » (sic Jean Chapelain) –, d’avoir « par la simplicité des mots, facilité la mémorisation des airs, que les Parisiens fredonnaient dans la rue », comme l’avait aussi souligné Voltaire.
Mais qui faisait réellement la cuisine?
NB De témoignages, il ne manque pas : de Jean-François de La Harpe ou de Lecerf de la Viéville, qui confortent ces propos.
Et signalons au passage que la fiche Quinault Wikipedia est un pur reprint (sans vraie indication de source, ni augmentations…) du Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Paris, Librairie Hachette & Cie, 1876, 1884 (2è éd.), p. 1674-1675…
Diantre, Collodi vient ferrailler derechef, et avec des arguments précis Oh, que vous êtes dur avec ce prologue plein d’humour justement, où Lully cire outrageusement les pompes de son boss Louis ! Ce n’est que du second degrés, Lully et Quinault ont du se tordre de rire lors de la composition.
Ensuite, l’opéra en lui-même, noir et tragique ? Exact. Voulu, revendiqué, écrit dans un esprit racinien, où pour la première fois le héros meurt sur scène. Le Roi n’est déjà plus tout jeune, il ne danse même plus, l’époque de l’insouciance est terminée, le pouvoir fort se met en place, il n’est plus temps des rires et des chants. C’est justement cette noirceur qui est étonnante et magnifique.
Serons-nous un jour d’accord Collodi ? Mais continuez à poster vos remarques érudites, j’apprends plein de choses