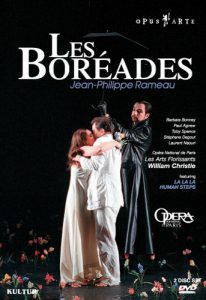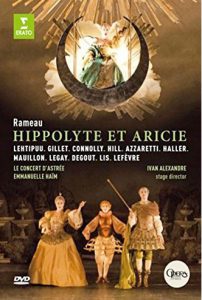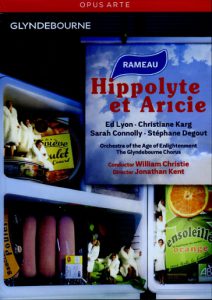Acis et Galatea, 1718
Georg Friedrich Haendel, 1718
Enregistré à Covent Garden en 2009 / DVD 2010
Si vous êtes gourmand du travail du metteur en scène et chorégraphe Wayne McGregor, qui accompagnait déjà l’Orchestre de l’Âge des Lumières (Orchestra of the Age of Enlightenment) conduit par Christopher Hogwood dans une version de Didon et Ènée coupante et racée, vous savourerez avec délectation cet Acis and Galatea, où l’on chante (très bien) et où l’on danse (tout autant).
Ce petit « opéra » en deux actes turlupine les musicologues, tant il est épineux de le rattacher à un genre ; « masque », « pastorale », « serenata », « divertissement musical », voire un « presque-oratorio »… qui dit mieux, n’en jetez plus, la confusion règne. Tentons un rapide retour en arrière pour dissiper le brouillard. Dès 1708, Haendel s’inspire des Métamorphoses d’Ovide et crée à Naples une « serenata », Aci, Galatea e Polifemo. Ce genre particulier se donne souvent la nuit, en plein air, composé à la demande d’un puissant pour une représentation privée, sans mise en scène, les chanteurs interprétant des héros, des dieux ou des figures mythologiques, la partition à la main. Dix années plus tard, non loin de Londres, à la demande de son employeur le Duc de Chandos, toujours pour une soirée réservée à quelques happy few en sa demeure, Haendel compose Acis and Galatea, donnée, comme nous dirions maintenant, en version concert, le compositeur étant loin d’imaginer qu’elle serait un jour mise en scène comme un opéra véritable. Cette œuvre sera d’ailleurs l’une des plus jouées du vivant du compositeur, remaniée par ses soins dans une seconde version en 1732 puis dans une troisième en 1741, reprise quelquefois sans son accord, sous des termes différents d’« opéra pastoral » et surtout de « masque », une manière comme une autre de la placer en perspective des spectacles anglais de Purcell mais aussi de repousser symboliquement l’invasion de l’opéra italien outre-Manche. La présence d’un chœur, inattendu pour une « serenata » (allons-y, puisque Haendel utilise le terme), l’emmène déjà vers l’oratorio. Nous voilà donc en présence d’une œuvre protéiforme, reliant le sud et le nord, la tradition élisabéthaine à l’opéra moderne.
Œuvre courte prévue pour un public restreint, Acis and Galatea n’est pas dotée d’un livret très subtil et ni de personnages complexes. L’histoire pourrait même être cataloguée comme un brin simplette et le texte comme… gentillet. Le berger Acis aime Galatea, nymphe marine aux pouvoirs divins, malgré les mises en garde des autres pâtres, qui présagent une relation difficile. Galatea partage pourtant ses sentiments et tous les deux se réjouissent de leur amour mutuel. Le cyclope monstrueux Polyphème descend de sa montagne pour ravir Galatea, qui repousse ses avances et jure fidélité à son berger. De rage, Polyphème arrache un rocher de sa montagne, qui écrase Acis. Galatea, fille de Nérée, use de son art pour transformer Acis en rivière, qui rejoindra éternellement la mer.
Alors que faire d’une œuvre minimaliste, qui ne brille que par sa partition ? Comment lui donner de l’épaisseur, comment construire une mise en scène, jamais envisagée par Haendel, autour d’un fil aussi ténu ? Wayne McGregor, metteur en scène et chorégraphe, sonde ses personnages en travaillant « leur altérité », leur magie, leur contradiction, en les disloquant. Chaque rôle est alors dédoublé, le chanteur incarnant physiquement le personnage, en restant dans ce qui est rationnellement prévisible de son caractère, quand le danseur, vêtu d’une simple body couleur chair, reflète le petit supplément d’âme qui complexifie chaque individu. D’où des décalages, des contradictions, des dissonances parfois entre ce que l’on entend et ce que l’on voit. Le géant Polyphème, vigoureusement campé par la basse Matthew Rose, à demi-nu, couvert de bleus et de griffures, bedaine débordante, est dansé par un bondissant garçon longiligne, nerveux et fébrile, comme si son esprit était prisonnier de ce corps lourd, brutal, violent, et se heurtait sans cesse à cette enveloppe physique sauvage qu’il subit. Même lorsque le géant se pose le temps d’un solo, le danseur s’agite sans relâche, les sens en éveil, le cœur palpitant pour cette nymphe qui le repousse. La danse devient alors plus révélatrice que le chant, exprimant ce qu’il y a de plus viscéral, de plus intime du personnage.
Acis and Galatea s’ouvre sur un trompe-l’œil très « pastorale », stylisé comme Le paradis de Cranach (Wayne McGregor va jusqu’à planter sur scène des animaux factices), avec un petit temple grec, puis s’allège, se stylise, s’assombrit, se dépouille, et demeure juste un écrin pour les interprètes. Le décor, comme les costumes, demeure modeste, pour que le spectateur reste focalisé sur cette double interprétation de l’œuvre (même si la perruque blonde très Walkyrie de Galatea et le pull vert tricoté main d’Acis m’ont laissée perplexe).
Si les membres du Royal Ballet sont épatants (moi qui suis habituellement réfractaire à la danse, je n’ai à aucun moment soupiré d’ennui), les voix le sont également. La baroqueuse Danielle de Niese (Sémélé, Les Indes galantes, Le Couronnement de Poppée, Jules César…) est comme toujours ébouriffante : la soprano est une bombe qui sait tout faire, elle déboule sur scène le visage barré d’un sourire ensoleillé, déjà au taquet, et lance sa voix sans se ménager. C’est une présence, une énergie, aussi crédible en amoureuse languissante, qu’en nymphe éplorée et qui ose un vrai pas-de-deux final avec un danseur, dont elle n’a pas à rougir. Sa voix est ronde, vigoureuse, rouge fringant, sans jamais forcer sur les effets. Elle sait équilibrer sa puissance pour se mettre au niveau de ses partenaires masculins, sans chercher à les pulvériser. Paul Agnew est hélas un peu en dehors, surtout dans son premier air, le timbre fatigué, défaillant, récupérant un peu d’habileté dans le II. Il faut le réécouter dans l’excellent CD « Divine Hymns » de Purcell dirigé par Christie et oublier ce petit accroc qui, je le souhaite, n’augure pas d’un délabrement de ses capacités vocales.
Les airs du chœur, les duos, les trios, sont de purs délices, sous la direction d’un Christopher Hogwood qui insuffle à la partition une grande fermeté. Son ouverture menée tambour battant présage non d’une fade bluette sucrée mais d’une œuvre somptueuse, qui passe du vert tendre au noir, avant un dénouement heureux où la nymphe danse avec l’esprit de son bien-aimé, pour l’éternité.