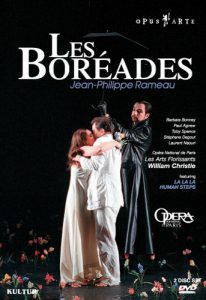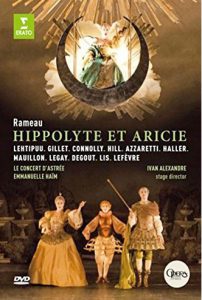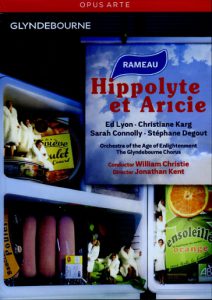Didon et Énée, 168?
Henry Purcell
Enregistré à Covent Garden en 2009 / DVD 2009
Didon et Énée, œuvre minimaliste d’une heure, est une anomalie dans l’Angleterre du XVIIème siècle : les contemporains de Purcell goûtent les longs « semi-opéras », – King Arthur, The Fairy Queen…-, ces spectacles où se joignent théâtre, musique, danse, machinerie, décor féerique pour des extravagances permises et souhaitées. L’opéra, comme nous l’entendons, était alors la prérogative des Italiens, dont la langue passait pour plus adaptée au chant, que l’Anglais. Je n’ai jamais bien compris cet argument (en quoi la langue anglaise était-elle un obstacle à un spectacle entièrement chanté ?). D’autant plus que des troupes itinérantes ont tenté d’implanter à Londres l’opéra italien sans trouver de public, qui ne s’y intéressa pas avant le début du XVIIIème siècle. Les Anglais préféraient peut-être tout simplement les divertissements fantaisistes, où tous les arts avaient leur place sur scène, dans un joyeux mélange de numéros cocasses et extravagants. Le music-hall avant l’heure.
On ne connaît toujours pas aujourd’hui les raisons de la naissance de cette œuvre : on la pensait composée en 1689, pour un pensionnat de jeunes filles (alors que le thème peut sembler très incongru pour des jouvencelles). Les dernières recherches prouveraient une certaine parenté de composition entre Didon et Énée et Venus et Adonis de John Blow, professeur et ami de Purcell. Venus et Adonis fut créée en 1681, pour divertir le Roi, et donnée quelques années après dans le même pensionnat. Les spécialistes de Purcell s’entendent désormais sur le fait que l’opéra a dû être présenté à la cour du roi Charles II dès 1684, mais sous quelle forme ? Après la mort de Purcell, la partition sera adaptée, découpée pour accompagner des pièces de théâtre. Et le seul manuscrit, incomplet, qui nous soit parvenu résulte de nombreuses « révisions ».
La version de Wayne Mac Gregor, dirigée par Christopher Hogwood, magnifie le travail de Purcell. Elle fait de Didon et Énée une tragédie, un drame très sombre que rien ne vient parasiter, focalisé sur une femme qui va payer de sa vie le fait de s’être abandonnée à l’amour : décor dépouillé, formes géométriques épurées, rectitude des lignes, costumes neutres et intemporels, jeux de lumières en clair-obscur, rien qui puisse raccrocher le drame à une réalité historique (même si l’influence japonaise des costumes est indiscutable). La version de l’Opéra-Comique en 2008 m’avait énormément frustrée : la mise en scène nous emmenait dans un univers « badin », galant, où l’on cherchait à faire joli et raffiné, à grand renfort de décors chargés, de robes lourdes, de marins acrobates et de gamins qui cavalaient sur scène. Une suite d’idées datées et sans cohérence, un bazar plat, chanté sans émotion. Or, la force de Didon et Énée réside dans la seule musique. Elle y est tellement poignante, tellement douloureuse que la mise en scène doit se faire toute petite devant elle, elle doit servir la partition, non se mettre en avant. C’est exactement le choix de Mac Gregor.
Evidemment, quand on ne peut se cacher derrière les artifices d’une mise en scène brouillonne et bruyante, il faut être une interprète de grande classe. Et dans cette production, c’est carton plein. Le rôle de la reine de Carthage est taillé pour les épaules de Sarah Connolly : point de simagrées, de maniérisme chez la mezzo britannique. Elle campe une souveraine tragique, droite, tourmentée par son devoir, qui hésite à déclarer ses sentiments au prince troyen. Elle pressent que l’idylle sera de courte durée et que son destin n’est pas de couler des jours heureux. Sa voix est parfaitement placée dès le début de l’acte I, ample, riche, pleine dans les graves. Le public retient son souffle pour le fameux « When I am laid in earth… », que Connolly contient jusqu’à son dernier souffle. C’est brutal, âpre, funeste et juste somptueux.