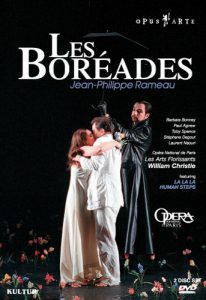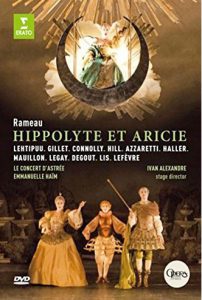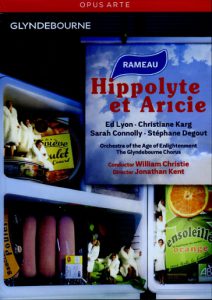L’Incoronazione di Poppea, 1642
Claudio Monteverdi,
Enregistré au festival d’Aix en 2000 / DVD 2005
Cette œuvre tardive de Monteverdi est certainement un de mes opéras préférés : composé juste après Le retour d’Ulysse – pensum dévoué aux bons sentiments et assommant au possible – Le Couronnement de Poppée laisse loin derrière lui les pastorales bucoliques, les interventions des habitants de l’Olympe, le charme falot de l’Arcadie au profit d’une histoire profane, de passions humaines déchaînées, d’un drame où règnent pouvoir, désir, meurtre et dépravation. Les héros ne sont plus des demi-dieux ou des guerriers légendaires mais des créatures qui nous ressemblent, manipulatrices, infâmes, ambitieuses.
L’Empereur Néron, marié à Octavie, nourrit une passion dévorante pour Poppée, jeune intrigante arriviste, prête à renier tous principes (dont l’amour du tendre Othon) pour évincer l’épouse légitime et porter les lauriers d’Impératrice. Elle parviendra, en jouant des sens de Néron, à obtenir le pouvoir, l’Amour sensuel imposant sa suprématie sur la Vertu et le Destin.
Le Couronnement de Poppée est une œuvre luxuriante, profonde, où le tumulte des passions mène furieusement au crime, où l’égoïsme et la démence des puissants triomphent de la morale, de l’honnêteté du peuple, dans une folie débridée. Elle offre des personnages complexes, des contrastes marqués, de brusques changements de situation et de ton (alternance de scènes cocasses, indécentes, tragiques), des langages bigarrés (réflexions philosophiques de Sénèque, transes amoureuses des deux amants coupables, lamentations d’Othon, élégies d’Octavie). Mais la structure reste harmonieuse car tous les personnages (à l’exception de Sénèque, voix bafouée de la raison qui domine ces turpitudes) sont pris dans la ronde frénétique de toutes sortes d’amours : concupiscence chez Néron, convoitise avide chez Poppée, amour offensé chez Octavie, passion sans espoir chez Othon, sacrifice amoureux de Drusilla pour Othon.
Deux seuls manuscrits de la partition nous sont parvenus, l’un, datée de 1646, trouvé à Venise en 1888, le second, daté de 1651, trouvé à Naples en 1930. Les deux diffèrent. Libre est donc le chef d’orchestre d’agrémenter la ligne de basse continue comme il pense devoir le faire. Chacun prend des deux versions, coupe, agrémente d’autres airs, choisit les harmonies, l’instrumentation. Le magnifique air final « Pur ti miro » n’est pas de Monteverdi mais de Ferrari. Il est donc impossible de retrouver ce que Monteverdi a dirigé lors de sa création en 1643 mais chaque chef tente de restituer le « style » monteverdien.
Marc Minkowski et Klaus Michael Gruber ont pratiqué un certain nombre de coupes (disparition d’un personnage, scènes jugées inutiles) pour privilégier un spectacle intime, resserré, troublant avec un orchestre adapté au lieu (basse continue à 14 musiciens) et des ajouts du violoniste Marini, pour marquer les changements d’atmosphère.
Le tour de force de cette mise en scène est de suggérer les passions dévastatrices des personnages sans jamais épaissir le trait : tous se frôlent, se dérobent, s’effleurent, font naître une tension palpable ; la folie les consume, la volupté bridée les électrise. Mireille Delunsch (Poppée) règne sur cette partition lascive : dans sa longue robe blanche qui la couvre des pieds à la tête, elle manœuvre, envoute, piège un empereur avec un habile mélange de fragilité, de grâce sensuelle et de d’insensibilité cruelle. Comme toujours Delunsch rayonne, irradie, et l’on reste ébahi devant l’intensité des émotions qui passent dans sa voix. Á ses côtés, le Néron colérique et instable campé par Von Otter déconcerte. Le vice triomphe du devoir d’état et la voix de la mezzo a bien du mal à garder sa souplesse dans cette succession brutale de fureurs, d’extases, de frasques fantasques.
Les personnages semblent flotter dans le décor immense, dépouillé, glacial, sombre écrin de leurs égarements. Le rouge éteint des villas de Pompéi, le noir et les ombres du jardin de Sénèque, le clair-obscur, les lumières froides contrastent avec le brasier et la violence qui flambent dans leurs veines. Minkowski refuse les ornements faciles et tient ses troupes serrées : le drame ne faiblit pas, l’intensité est là.