Mais c’est à désespérer ! Encore un magistral bouillon que cette Traviata montée à Milan pour l’ouverture de la saison à la Scala. Ou plutôt démontée, déformée, volontairement déséquilibrée, pour satisfaire les aspirations narcissiques d’un metteur en scène très perturbé : lire un livret, plonger dans la partition ? Non, Tcherniakov connaît seul la vérité révélée de l’œuvre et tant pis s’il enfile contresens, aberrations et inepties, en plaquant des choix toxiques sur l’œuvre de Verdi.
On ne fait pourtant pas plus simple, La Traviata est un mélodrame, porté par les airs les plus célèbres du répertoire lyrique. Passé au jus de crane gâté de Tcherniakov, on n’y retrouve plus ses petits. La jeune demi-mondaine fraîche, délicate et phtisique, devient une plantureuse catin de bas étage sur le retour, attifée comme une mémère, limite poissarde dans ses attitudes, la croupe trop large et le geste outré. Pas une once d’émotion, de raffinement, de grâce, mais des scènes sur-jouées et insensées (Violetta prend amicalement le thé avec Germont Père alors qu’elle accepte de se sacrifier pour l’honneur familial (sic), Alfredo passe ses nerfs en étalant de la pâte à tarte et en découpant furieusement céleris et carottes lorsqu’il comprend que sa belle est partie, Violetta finit alcoolique et camée au médocs, Alfredo vient la retrouver au III, raide et glacial, des fleurs et des pâtisseries à la main, comme en visite chez une vieille tante, alors qu’il va dire adieu à l’amour de sa jeunesse qui se meurt… Les exemples de distorsions entre la musique, le texte et la mise en scène sont pléthores). Le metteur en scène Tcherniakov serait parti du principe qu’Alfredo n’a jamais aimé Violetta. Mais de quel droit un tel postulat, puisqu’aux antipodes de la musique et de l’intrigue, méticuleusement piétinée ? Les trois actes sont esthétiquement laids, les déplacements frénétiques, les jeux de scènes saugrenus, voire incohérents et on se prend – quelle hérésie ! – à regarder sa montre. Car une Traviata sans sentiment, sans tension, sans drame, sans larme, c’est assommant. Le spectacle n’est pas décalé mais à côté.
Evidemment, les voix suivent le parti pris de Tcherniakov et Piotr Beczala a pris très cher hier soir, hué par une salle qui lui a fait injustement payer son Alfredo dédaigneux et réfrigérant. Oui, le manque de douceur, de sensibilité, de compassion était flagrant, oui, le II était plus braillé que chanté, mais la responsabilité ne lui incombe en aucun cas. Le baryton Lucic est efficace, droit dans ses bottes, bien dans son rôle, sans surprise. Et puis il y a Diana Damrau… qui n’a plus l’âge* ni le physique du rôle, plus proche de celui d’une walkyrie. Surtout quand la voix aussi s’enlise dans des choix douteux. Violetta, c’est un subtil mélange de force et de fragilité, d’assurance et de fêlures, de maîtrise et d’abandon, ça ne doit jamais être une démonstration. Et Damrau oublie d’épouser tous les angles du personnage en chantant monocorde, bien campée sur ses cuisseaux. Comment peut-on interpréter « Dite alla giovine » sans provoquer un fleuve de larmes dans le public ? Même son « Addio del passato » m’a laissée de marbre. Émotionnellement, c’est le degré zéro, le néant, le vide. Alors la bronca lancée à plein poumon par une Scala vent debout lors des saluts, nous l’avons partagée ; les Italiens ne pouvaient se laisser prendre aux simagrées d’un metteur en scène arrogant, et ça, c’est rassurant.
* Oui, je persiste, il y a une date de péromption pour certains rôles… même pour Natalie Dessay en 2011…
PS : Dessay = 0, Damrau = 0, Delunsch, toujours loin devant…

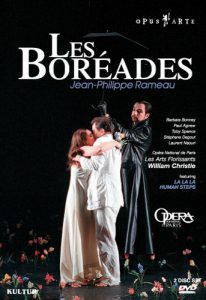
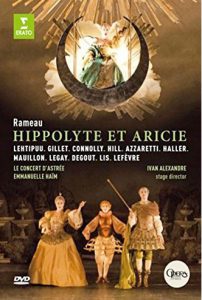
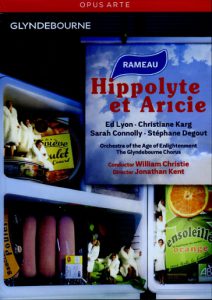
Salé mais mérité !
Un peu dure pour Diana Damrau tout de même. Seul Germont père fut juste. Mise en scène en contre sens totale avec le texte, il y a comme un malaise. Malheureusement incriticable, hé c’est d l’art ! J’ai horreur du coté, si vous n’avez pas aimé c’est soit que vous êtes rétrograde, soit que vous n’avez rien compris. Quel mépris du public parfoit.